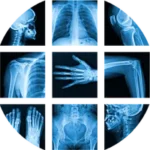Spécialité : pediatrie / toxicologie /
Points importants
- Accumulation intra-érythrocytaire de méthémoglobine : dérivé de l’Hb incapable de lier l’O2 = fer ferreux (Fe2+) de l’hème oxydé en fer ferrique (Fe3+)
- Symptôme : CYANOSE résistante à l’oxygénothérapie
- Enfant = Héréditaires (rares) :
- cyanose de naissance (MétHb permanente de 15 à 50%) par déficit enzymatique congénital
- Adulte = acquises (toxiques) :
- médicamenteuse : ALR, soins dentaires, substances illicites
- professionnelle : industrielles (peintures, herbicides, allumettes)
- alimentaire/environnementale : chlorates (eau), nitrates (charcuterie)
- Taux physiologiques :
- adulte < 0,80% (de Hb totale)
- nouveau-né < 1,5% (Prématuré < 2%)
- Traitement : bleu de méthylène IV
Présentation clinique / CIMU
SIGNES FONCTIONNELS
Généraux
- Cyanose
Spécifiques
- Signes d’hypoxie tissulaire corrélés au % de MetHb
- Symptômes en fonction du taux de méthémoglobine (en % de l’Hb totale) :
- 0 – 15 : pas de symptômes
- 15 – 20 : cyanose clinique, sang « chocolat »
- 20 – 45 : dyspnée, asthénie, vertiges, céphalées, syncopes
- 45 – 55 : dépression neurologique centrale
- 55 – 70 : coma, convulsions, insuffisance circulatoire, TDR
- > 70 : décès possible
CONTEXTE
Terrain
- Nouveau-né : en salle de naissance
- Enfant : héréditaire = déficit enzymatique congénital
- Adulte : acquis = intoxication volontaire ou involontaire (intoxication chimique) par consommation d’aliments contaminés par les nitrites
Antécédents
- Enfant : congénitale
- Adulte : Pas d’ATCD cardiaque ni pulmonaire
Facteurs de risque
- Enfant : autosomique récessif
- Adulte :
- intoxication médicamenteuse (surdosage ou non) :
- injection locale/dispositif transcutané d’anesthésiques loco – régionaux
- soins dentaires
- ingestion d’antilépreux
- ingestion/inhalation/injection de substances illicites type « poppers »
- intoxication professionnelle :
- inhalation de solvants industriels, herbicides, explosifs (chlorates, allumettes)
- intoxication alimentaire/environnementale :
- eau
- charcuterie
- intoxication médicamenteuse (surdosage ou non) :
Circonstances de survenue (non exhaustives)
- Médicaments méthémoglobinisants :
- benzocaïne (éthyle aminobenzoate) :
- anesthésie locale :
- gel dentaire
- ORL (topiques auriculaires)
- crème anorectale
- examen médical/exploration (bronchoscopie, ETO)
- anesthésie locale :
- prilocaïne :
- transcutané lidocaïne + prilocaïne crème (EMLA 5%)
- soins dentaires
- dapsone :
- antilépreux en indications secondaires pour maladies rhumatismales, maladies inflammatoires digestives, leishmanioses, polychondrite…
- poppers (amyle nitrite) :
- substance illicite, interdite en France
- liquide volatile à usage aphrodisiaque
- benzocaïne (éthyle aminobenzoate) :
- Toxiques professionnels méthémoglobinisants :
- nitrobenzène :
- industries : explosifs, colorants, peintures
- solvant, odeur amandes amères
- toxicité : MétHb, SulfHb, hémolyse
- chlorates :
- chlorate de sodium NaClO3 (herbicides)
- chlorate de potassium KClO3 :
- anciennes préparations pour solution buccale
- colorants
- explosifs (allumette)
- dose létale :
- NaClO3 = 15 g
- KClO3 = 7 g (1g chez l’enfant » 20 allumettes)
- nitrobenzène :
- Intoxication alimentaire (composes inorganiques) :
- nitrates :
- eaux :
- eaux souterraines : engrais azoté agricole non absorbé
- eaux de surface : eau potable selon OMS < 50 mg/L NO3– (< 3 mg/L NO2)
- aliments :
- naturellement (laitue, épinard)
- charcuterie (nitrite de sodium)
- eaux :
- nitrates :
EXAMEN CLINIQUE
Cyanose
- Enfant : cyanose de naissance +/- troubles neurologiques (selon importance du déficit enzymatique)
- Adulte : cyanose « centrale » :
- gris ardoisé, non corrigée par l’oxygénothérapie
- cutanéomuqueuse diffuse
- sans cause cardiaque, ni pulmonaire
- apparition brutale, entre 1h et 24h après l’intoxication
Urines foncées (brunes)
Signes d’hypoxie tissulaire : critères de gravité
Signes cardio-circulatoires
- Collapsus dans les intoxications sévères avec un taux de méthémoglobinémie > 30%
Signes neuropsychiques
- Stigmates de convulsions (morsure de langue, contusions cutanées, des plaies cutanées…)
- Altération de la conscience, voire coma
EXAMENS PARACLINIQUES SIMPLES
- SpO2 abaissée, souvent sous-estimée
- Oxymétrie de pouls : % de MetHb par rapport à l’Hb totale (spectrophotométrie indirecte)
- ECG : recherche d’ischémie (critère de gravité)
En pratique, une cyanose non corrigée par l’apport de l’oxygène avec désaturation clinique contrastant avec une PaO2 normale oriente vers une intoxication à un produit méthémoglobinisant
CIMU
- Tri 2 voire 1
Signes paracliniques
BIOLOGIQUE
GDS artériels
- Mesure du % de MetHb par rapport à l’Hb totale par Spectrophotométrie directe (non réalisé en routine) :
- pic d’absorption = 630 nm
- diagnostic différentiel SulfHb (620nm)
- Sang brun « chocolat »
- pH normal
- PaO2 normale voire augmentée
- SaO2 normale ou abaissée
- MetHb > 1%
- Critère de gravité : acidose métabolique
NFS
- Recherche d’une anémie (facteur aggravant)
IMAGERIE
- Radio pulmonaire : normale
Diagnostic étiologique
Voir « circonstances de survenue » dans présentation clinique
- Une cyanose non corrigée par l’apport de l’oxygène avec désaturation clinique contrastant avec une PaO2 normale oriente vers une intoxication à un produit méthémoglobinisant :
- congénital : déficit enzymatique
- acquis :
- médicaments méthémoglobinisants
- substances illicites
- toxiques professionnels méthémoglobinisants
- intoxication alimentaire (composés inorganiques)
- Modalités de l’intoxication (à visée thérapeutique) :
- inhalation
- ingestion
- injection
- transcutané
Diagnostic différentiel
- Cyanose d’origine cardiaque ou pulmonaire
- Sulfhémoglobinémie (irréversible) : intoxication à l’hydrogène sulfuré ou aux sulfamides
- Méthémalbuminémie
Traitement
TRAITEMENT PREHOSPITALIER / INTRAHOSPITALIER
Stabilisation initiale
- Voie d’abord veineuse avec NaCl 0,9%
- Scope
- Oxygénothérapie à fort débit, sous une FiO2 à 100% avant même la réception de la méthémoglobinémie ; elle permet d’augmenter la quantité d’oxygène dissous et de saturer l’hémoglobine fonctionnelle restant encore fonctionnelle
- Traitement symptomatique des signes cliniques associés :
- correction de l’HoTA
- anticonvulsivants
- contrôle des voies aériennes
- Traitement évacuateur :
- lavage gastrique dans les 2 heures suivant l’ingestion
- charbon activé
- Bleu de méthylène IV
Suivi du traitement
- Si MetHb < 30% : possible régression spontanée de la cyanose en 24 à 72 h
- Correction des symptômes associés à l’hypoxie AVANT la régression de la cyanose
- Si MetHb > 30% : amélioration de la clinique dans l’heure suivant l’administration du bleu de méthylène
- Autre traitement: l’exsanguino-transfusion :
- en cas d’intoxication massive menaçant le pronostic vital (méthémoglobinémie > 60%)
- en cas d’échec du bleu de méthylène (déficit en G6PD)
MEDICAMENTS
Traitement « spécifique » : bleu de méthylène (chlorure de tétraméthylthionine 1%)
- Indications :
- signe d’hypoxémie
- MétHb > 30%
- Ampoule de 5 mL à 1% = 50 mg/amp
- Modalités :
- IV stricte (risque de nécrose tissulaire)
- 1 à 2 mg/kg (nouveau-né 0,3 à 1 mg/kg)
- dilué dans NaCl 0,9% ou G5%
- IVL : 10 à 15 min
- renouvelable à H1 : 1 mg/kg (dose totale max. 7mg/kg)
- Délai d’action : 20 min
- Surveillance :
- fonction rénale
- coloration des urines (bleu, vert)
- Contre-indications :
- allergie vraie au bleu de méthylène
- insuffisance rénale sévère (relative)
- déficit en G6PD
- déficit en NADH-réductase
- Effets indésirables :
- coloration des téguments (bleu)
- hémolyse (+/- déficit en G6PD)
- en cas de dose excessive :
- douleur thoracique, abdominale
- vertige, céphalée, obnubilation
- dysurie
- dyspnée
- HoTA/HTA
- Echec du traitement par bleu de méthylène :
- déficit en G6PD
- déficit en NADPH – MétHb – réductase
- cyanose non MétHb : aggravation de l’hypoxie tissulaire
- persistance du toxique
- sulfhémoglobine (isolée, associée)
- hémolyse associée (selon toxique)
Surveillance
CLINIQUE
- Disparition des symptômes d’hypoxie
- Régression de la cyanose cutanéo – muqueuse
- Restauration d’une SpO2 normale
- Attention à l’effet rebond possible de certains toxiques (dapsone, benzocaïne, aniline : 4 à 12 h après un traitement efficace par bleu de méthylène)
PARACLINIQUE
- Méthémoglobinémie : dosages répétés 2 à 3 fois par 24 h (cinétique décroissante)
Devenir / orientation
CRITERES D ADMISSION
En Service de Médecine
- Si aucun signe de gravité clinique :
- systématique pendant 24 h minimum
- tant que persistance de la cyanose et MetHb > 1%
En Réanimation
- Signes d’hypoxie tissulaire grave
- Détresse circulatoire/respiratoire/neurologique
- Et/ou échec du traitement initial
CRITERES DE SORTIE
- Régression complète de la symptomatologie
- MetHb < 1%
ORDONNANCE DE SORTIE
- Aucune
RECOMMANDATIONS DE SORTIE
- Education du patient :
- éviction définitive du toxique incriminé
- liste des toxiques potentiels à éviter et/ou situations à risque
- Enquête professionnelle, accident du travail/maladie professionnelle, reclassement
- Enquête environnementale, signalement (DDASS/DRASS)
Mécanisme / description
METABOLISME
- Accumulation intra-érythrocytaire de méthémoglobine : dérivé non fonctionnel de l’Hb : fer ferreux (Fe2+) de l’hème oxydé en fer ferrique (Fe3+), incapable de lier l’O2
- Production physiologique quotidienne = 3% de l’Hb totale
- 2 systèmes de réduction :
- voie principale NADH dépendante avec la NADH – cytochrome – b5 – réductase (glycolyse anaérobie => NADH)
- voie accessoire NADPH dépendante avec la NADPH – MetHb – réductase (glycolyse aérobie via shunt des pentoses => NADPH) utilisant le G6PD
- voie accessoire activée par le bleu de méthylène
- Défaillance des systèmes enzymatiques réducteurs :
- impuissants : hémoglobinopathie
- anormaux : réduction impossible
- débordés : intoxication par des agents oxydants
PHARMACODYNAMIE
- Elimination spontanée physiologique jusqu’à 30% de MetHb en 24 à 72 h
Bibliographie
- Danel V. Les intoxications aiguës. Ed. Arnette 1993, Paris, p 49 – 58
- Carli P., Riou B., Télion C. Urgences Médico – Chirurgicales de l’Adulte. Ed. Masson 2004, Paris p. 1210 – 1214
- Bauvais P. La méthémoglobinémie héréditaire récessive, Encyclopédie orphanet, fév.2004, http://www.orpha.net/data/patho/FR/fr-mhr.pdf
- Thomas J. Moore et al. Reported adverse event cases of methemoglobinemia associated with benzocaine products. Arch Intern Med. 2004; 164 : 1192-1196
- Rudolf B. et al. The use of oxymetry in prilocaine induced methemoglobinemia. Anaesthesist. 1995; 44 (12): 887-891
- Peter C et al. Pharmocokinetics and organ distribution of intravenous and oral methylene blue, Eur J Clin Pharmacol. 2000, 56 : 247-250
- Rodriguez LF. Benzocaine induced methemoglobinemia : report of a severe reaction and review of the literature. Ann Pharmacoter. 1994; 28 (5) : 643-649
- Cury S. Methemoglobinemia. Ann Emerg Med. 1982 ; 11 : 214 – 221
Auteur(s) : Armelle ALHERITIERE, Clotilde CAZENAVE
Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application
- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com