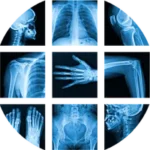Bilirubine
La bilirubine est le produit de la dégradation de l’hémoglobine dans la rate. Libérée dans le plasma sous une forme insoluble dans l’eau, elle est véhiculée vers le foie liée à l’albumine. Dans le foie elle est conjuguée par le glucuronate, ce qui la rend soluble puis elle est excrétée par les voies biliaires dans l’intestin.
La bilirubine conjuguée, soluble dans l’eau et présente dans les voies biliaires est dite « directe » ; la bilirubine non conjuguée, libérée par la destruction des hématies et présente dans le sang, est dite « indirecte ».
Le dosage de la bilirubine totale confirme le diagnostic d’ictère. Celui de ses composantes en précise le mécanisme.
Indications
• Toutes les maladies hépatobiliaires (le dosage est inclus dans le « bilan hépatique complet »).
• Recherche d’une hémolyse devant une anémie régénérative (avec des réticulocytes élevés).
• Chez le nouveau-né : recherche d’un ictère hémolytique du nouveau-né par incompatibilité fœtomaternelle, d’une atrésie biliaire.
Prélèvement de sang capillaire (enfant) ou veineux (adulte) sur tube sec ou hépariné.
U Éviter la stase veineuse. Rejeter les prélèvements lorsque le garrot a été mis en place plus de 1 min.
U Éviter l’exposition du prélèvement à la lumière (la bilirubine s’oxyde à la lumière). En pédiatrie, utiliser de préférence des flacons ambrés ou enveloppés dans du papier d’aluminium.
Valeurs usuelles
• Bilirubine totale :
- 12 mg/L (20 pmol/L)
• Bilirubine indirecte (non conjuguée) :
- 10 mg/L (18 pmol/L)
• Bilirubine directe (conjuguée) :
- 2 mg/L (4 pmol/L)
• Un ictère est cliniquement décelable lorsque la bilirubine dépasse 50 pmol/L (30 mg/L).
• Certains nouveau-nés présentent un ictère « physiologique » dû à l’immaturité hépatique. La bilirubinémie peut atteindre 200 pmol/L le 3e jour. L’ictère disparaît rapidement et, le 5e jour, la bilirubine est < 35 pmol.
Interprétation
Hyperbilirubinémies conjuguées
Z”
L’hyperbilirubinémie conjuguée se signale par la présence de bilirubine dans les urines, qui sont foncées (la bilirubine conjuguée, à la différence de la non conjuguée, est hydrosoluble ; elle peut donc passer dans les urines). En revanche les selles sont décolorées faute de bilirubine dans l’intestin.
______________________________________________________ y
L’hyperbilirubinémie conjuguée est due à une cholestase. On entend par cholestase tout obstacle à l’écoulement biliaire « de l’hépatocyte à l’ampoule de Vater ». Une cholestase se reconnaît à l’élévation concomitante des gamma-glutamyl transpeptidases (yGT) et de la bilirubine. Elle peut être confirmée par le dosage de la 5′-nucléotidase. Une cholestase peut être extrahépatique ou intrahépatique. La distinction est faite à l’échographie selon que les voies biliaires sont dilatées (cholestase extrahépatique) ou non (cholestase intrahépatique).
Cholestase intrahépatique
La cholestase intrahépatique est liée à l’inflammation hépatique, à une hépatite – médicamenteuse principalement, mais aussi virale ou alcoolique -, ou encore à une cirrhose biliaire primitive (CBP) qui est une cholangite chronique auto-immune de la femme.
Dans les cholestases intrahépatiques, les transaminases sont élevées. Le taux de prothrombine est plus ou moins abaissé selon la gravité de l’insuffisance hépatique. Les examens de laboratoires (sérologie des hépatites par exemple) déterminent la cause de la jaunisse.
Cholestase extrahépatique
La cholestase est dite extrahépatique lorsque les voies biliaires sont obturées par une lithiase ou comprimées par une tumeur.
Dans ces ictères, le foie est gros. Les phosphatases alcalines sont proportionnellement plus élevées que les transaminases. Le taux
de prothrombine, abaissé, est corrigé par la vitamine K. L’imagerie détermine la cause de la jaunisse.
Hyperbilirubinémies non conjuguées
( ‘■ ‘■
Une hyperbilirubinémie est dite non conjuguée lorsqu’elle est constituée à 80 % ou plus de bilirubine libre (« indirecte »).
L’ictère est habituellement discret. L’excrétion biliaire intestinale de la bilirubine est augmentée, ce qui colore les selles, qui sont foncées.
______________________________________________________ z
L’hyperbilirubinémie non conjuguée est généralement due à une hémolyse, parfois à un défaut de glucuronoconjugaison.
Déficit en glucuronoconjugaison
Un déficit en glucuronoconjugaison fréquent et tout à fait bénin est la maladie de Gilbert (cholémie familiale). Cette affection à transmission autosomique dominante se traduit par un ictère familial chronique, modéré, isolé, facile à reconnaître.
La bilirubinémie (qui doit être dosée après un jeûne prolongé) ne dépasse pas 50 mg/L (85 mmol/L).
Hémolyse
En dehors de ce cas l’hyperbilirubinémie indirecte est due à une hémolyse (anémie hémolytique).
L’ictère hémolytique est habituellement discret. La bilirubine dépasse rarement 100 pmol/L. Les épreuves fonctionnelles hépatiques sont normales. L’anémie est régénérative. L’haptoglobine est abaissée, les lactates déshydrogénases (LDH) augmentées.
Toutes les hémolyses augmentent la bilirubine :
- anémies hémolytiques corpusculaires (Minkowski-Chauffard, déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD], etc.) ;
- anémies hémolytiques toxiques, médicamenteuses, parasitaires, immunologiques (transfusions, grossesse) ;
- anémies hémolytiques auto-immunes.
Chez le nouveau-né atteint d’hémolyse par incompatibilité fœto- maternelle, la production de bilirubine déborde rapidement les possibilités d’épuration, faibles à cet âge. La bilirubine se répand dans les tissus riches en lipides et imprègne les noyaux gris centraux du cerveau. Cet ictère nucléaire peut être mortel ou laisser de graves séquelles neurologiques.
! Chez le nouveau-né suspect d’incompatibilité fœtomaternelle, le dosage de la bilirubine est une urgence : de son résultat découle l’indication d’une photothérapie.
Prévenir l’équipe soignante dès que la bilirubine totale est augmentée
Bilirubine
La bilirubine est le produit de la dégradation de l’hémoglobine dans la rate. Libérée dans le plasma sous une forme insoluble dans l’eau, elle est véhiculée vers le foie liée à l’albumine. Dans le foie elle est conjuguée par le glucuronate, ce qui la rend soluble puis elle est excrétée par les voies biliaires dans l’intestin.
La bilirubine conjuguée, soluble dans l’eau et présente dans les voies biliaires est dite « directe » ; la bilirubine non conjuguée, libérée par la destruction des hématies et présente dans le sang, est dite « indirecte ».
Le dosage de la bilirubine totale confirme le diagnostic d’ictère. Celui de ses composantes en précise le mécanisme.
Indications
• Toutes les maladies hépatobiliaires (le dosage est inclus dans le « bilan hépatique complet »).
• Recherche d’une hémolyse devant une anémie régénérative (avec des réticulocytes élevés).
• Chez le nouveau-né : recherche d’un ictère hémolytique du nouveau-né par incompatibilité fœtomaternelle, d’une atrésie biliaire.
Prélèvement de sang capillaire (enfant) ou veineux (adulte) sur tube sec ou hépariné.
U Éviter la stase veineuse. Rejeter les prélèvements lorsque le garrot a été mis en place plus de 1 min.
U Éviter l’exposition du prélèvement à la lumière (la bilirubine s’oxyde à la lumière). En pédiatrie, utiliser de préférence des flacons ambrés ou enveloppés dans du papier d’aluminium.
Valeurs usuelles
• Bilirubine totale :
- 12 mg/L (20 pmol/L)
• Bilirubine indirecte (non conjuguée) :
- 10 mg/L (18 pmol/L)
• Bilirubine directe (conjuguée) :
- 2 mg/L (4 pmol/L)
• Un ictère est cliniquement décelable lorsque la bilirubine dépasse 50 pmol/L (30 mg/L).
• Certains nouveau-nés présentent un ictère « physiologique » dû à l’immaturité hépatique. La bilirubinémie peut atteindre 200 pmol/L le 3e jour. L’ictère disparaît rapidement et, le 5e jour, la bilirubine est < 35 pmol.
Interprétation
Hyperbilirubinémies conjuguées
Z”
L’hyperbilirubinémie conjuguée se signale par la présence de bilirubine dans les urines, qui sont foncées (la bilirubine conjuguée, à la différence de la non conjuguée, est hydrosoluble ; elle peut donc passer dans les urines). En revanche les selles sont décolorées faute de bilirubine dans l’intestin.
______________________________________________________ y
L’hyperbilirubinémie conjuguée est due à une cholestase. On entend par cholestase tout obstacle à l’écoulement biliaire « de l’hépatocyte à l’ampoule de Vater ». Une cholestase se reconnaît à l’élévation concomitante des gamma-glutamyl transpeptidases (yGT) et de la bilirubine. Elle peut être confirmée par le dosage de la 5′-nucléotidase. Une cholestase peut être extrahépatique ou intrahépatique. La distinction est faite à l’échographie selon que les voies biliaires sont dilatées (cholestase extrahépatique) ou non (cholestase intrahépatique).
Cholestase intrahépatique
La cholestase intrahépatique est liée à l’inflammation hépatique, à une hépatite – médicamenteuse principalement, mais aussi virale ou alcoolique -, ou encore à une cirrhose biliaire primitive (CBP) qui est une cholangite chronique auto-immune de la femme.
Dans les cholestases intrahépatiques, les transaminases sont élevées. Le taux de prothrombine est plus ou moins abaissé selon la gravité de l’insuffisance hépatique. Les examens de laboratoires (sérologie des hépatites par exemple) déterminent la cause de la jaunisse.
Cholestase extrahépatique
La cholestase est dite extrahépatique lorsque les voies biliaires sont obturées par une lithiase ou comprimées par une tumeur.
Dans ces ictères, le foie est gros. Les phosphatases alcalines sont proportionnellement plus élevées que les transaminases. Le taux
de prothrombine, abaissé, est corrigé par la vitamine K. L’imagerie détermine la cause de la jaunisse.
Hyperbilirubinémies non conjuguées
( ‘■ ‘■
Une hyperbilirubinémie est dite non conjuguée lorsqu’elle est constituée à 80 % ou plus de bilirubine libre (« indirecte »).
L’ictère est habituellement discret. L’excrétion biliaire intestinale de la bilirubine est augmentée, ce qui colore les selles, qui sont foncées.
______________________________________________________ z
L’hyperbilirubinémie non conjuguée est généralement due à une hémolyse, parfois à un défaut de glucuronoconjugaison.
Déficit en glucuronoconjugaison
Un déficit en glucuronoconjugaison fréquent et tout à fait bénin est la maladie de Gilbert (cholémie familiale). Cette affection à transmission autosomique dominante se traduit par un ictère familial chronique, modéré, isolé, facile à reconnaître.
La bilirubinémie (qui doit être dosée après un jeûne prolongé) ne dépasse pas 50 mg/L (85 mmol/L).
Hémolyse
En dehors de ce cas l’hyperbilirubinémie indirecte est due à une hémolyse (anémie hémolytique).
L’ictère hémolytique est habituellement discret. La bilirubine dépasse rarement 100 pmol/L. Les épreuves fonctionnelles hépatiques sont normales. L’anémie est régénérative. L’haptoglobine est abaissée, les lactates déshydrogénases (LDH) augmentées.
Toutes les hémolyses augmentent la bilirubine :
- anémies hémolytiques corpusculaires (Minkowski-Chauffard, déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD], etc.) ;
- anémies hémolytiques toxiques, médicamenteuses, parasitaires, immunologiques (transfusions, grossesse) ;
- anémies hémolytiques auto-immunes.
Chez le nouveau-né atteint d’hémolyse par incompatibilité fœto- maternelle, la production de bilirubine déborde rapidement les possibilités d’épuration, faibles à cet âge. La bilirubine se répand dans les tissus riches en lipides et imprègne les noyaux gris centraux du cerveau. Cet ictère nucléaire peut être mortel ou laisser de graves séquelles neurologiques.
! Chez le nouveau-né suspect d’incompatibilité fœtomaternelle, le dosage de la bilirubine est une urgence : de son résultat découle l’indication d’une photothérapie.
Prévenir l’équipe soignante dès que la bilirubine totale est augmentée
La bilirubine est le produit de la dégradation de l’hémoglobine dans la rate. Libérée dans le plasma sous une forme insoluble dans l’eau, elle est véhiculée vers le foie liée à l’albumine. Dans le foie elle est conjuguée par le glucuronate, ce qui la rend soluble puis elle est excrétée par les voies biliaires dans l’intestin.
La bilirubine conjuguée, soluble dans l’eau et présente dans les voies biliaires est dite « directe » ; la bilirubine non conjuguée, libérée par la destruction des hématies et présente dans le sang, est dite « indirecte ».
Le dosage de la bilirubine totale confirme le diagnostic d’ictère. Celui de ses composantes en précise le mécanisme.
Indications
• Toutes les maladies hépatobiliaires (le dosage est inclus dans le « bilan hépatique complet »).
• Recherche d’une hémolyse devant une anémie régénérative (avec des réticulocytes élevés).
• Chez le nouveau-né : recherche d’un ictère hémolytique du nouveau-né par incompatibilité fœtomaternelle, d’une atrésie biliaire.
Prélèvement de sang capillaire (enfant) ou veineux (adulte) sur tube sec ou hépariné.
U Éviter la stase veineuse. Rejeter les prélèvements lorsque le garrot a été mis en place plus de 1 min.
U Éviter l’exposition du prélèvement à la lumière (la bilirubine s’oxyde à la lumière). En pédiatrie, utiliser de préférence des flacons ambrés ou enveloppés dans du papier d’aluminium.
Valeurs usuelles
• Bilirubine totale :
- 12 mg/L (20 pmol/L)
• Bilirubine indirecte (non conjuguée) :
- 10 mg/L (18 pmol/L)
• Bilirubine directe (conjuguée) :
- 2 mg/L (4 pmol/L)
• Un ictère est cliniquement décelable lorsque la bilirubine dépasse 50 pmol/L (30 mg/L).
• Certains nouveau-nés présentent un ictère « physiologique » dû à l’immaturité hépatique. La bilirubinémie peut atteindre 200 pmol/L le 3e jour. L’ictère disparaît rapidement et, le 5e jour, la bilirubine est < 35 pmol.
Interprétation
Hyperbilirubinémies conjuguées
Z”
L’hyperbilirubinémie conjuguée se signale par la présence de bilirubine dans les urines, qui sont foncées (la bilirubine conjuguée, à la différence de la non conjuguée, est hydrosoluble ; elle peut donc passer dans les urines). En revanche les selles sont décolorées faute de bilirubine dans l’intestin.
______________________________________________________ y
L’hyperbilirubinémie conjuguée est due à une cholestase. On entend par cholestase tout obstacle à l’écoulement biliaire « de l’hépatocyte à l’ampoule de Vater ». Une cholestase se reconnaît à l’élévation concomitante des gamma-glutamyl transpeptidases (yGT) et de la bilirubine. Elle peut être confirmée par le dosage de la 5′-nucléotidase. Une cholestase peut être extrahépatique ou intrahépatique. La distinction est faite à l’échographie selon que les voies biliaires sont dilatées (cholestase extrahépatique) ou non (cholestase intrahépatique).
Cholestase intrahépatique
La cholestase intrahépatique est liée à l’inflammation hépatique, à une hépatite – médicamenteuse principalement, mais aussi virale ou alcoolique -, ou encore à une cirrhose biliaire primitive (CBP) qui est une cholangite chronique auto-immune de la femme.
Dans les cholestases intrahépatiques, les transaminases sont élevées. Le taux de prothrombine est plus ou moins abaissé selon la gravité de l’insuffisance hépatique. Les examens de laboratoires (sérologie des hépatites par exemple) déterminent la cause de la jaunisse.
Cholestase extrahépatique
La cholestase est dite extrahépatique lorsque les voies biliaires sont obturées par une lithiase ou comprimées par une tumeur.
Dans ces ictères, le foie est gros. Les phosphatases alcalines sont proportionnellement plus élevées que les transaminases. Le taux
de prothrombine, abaissé, est corrigé par la vitamine K. L’imagerie détermine la cause de la jaunisse.
Hyperbilirubinémies non conjuguées
( ‘■ ‘■
Une hyperbilirubinémie est dite non conjuguée lorsqu’elle est constituée à 80 % ou plus de bilirubine libre (« indirecte »).
L’ictère est habituellement discret. L’excrétion biliaire intestinale de la bilirubine est augmentée, ce qui colore les selles, qui sont foncées.
______________________________________________________ z
L’hyperbilirubinémie non conjuguée est généralement due à une hémolyse, parfois à un défaut de glucuronoconjugaison.
Déficit en glucuronoconjugaison
Un déficit en glucuronoconjugaison fréquent et tout à fait bénin est la maladie de Gilbert (cholémie familiale). Cette affection à transmission autosomique dominante se traduit par un ictère familial chronique, modéré, isolé, facile à reconnaître.
La bilirubinémie (qui doit être dosée après un jeûne prolongé) ne dépasse pas 50 mg/L (85 mmol/L).
Hémolyse
En dehors de ce cas l’hyperbilirubinémie indirecte est due à une hémolyse (anémie hémolytique).
L’ictère hémolytique est habituellement discret. La bilirubine dépasse rarement 100 pmol/L. Les épreuves fonctionnelles hépatiques sont normales. L’anémie est régénérative. L’haptoglobine est abaissée, les lactates déshydrogénases (LDH) augmentées.
Toutes les hémolyses augmentent la bilirubine :
- anémies hémolytiques corpusculaires (Minkowski-Chauffard, déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD], etc.) ;
- anémies hémolytiques toxiques, médicamenteuses, parasitaires, immunologiques (transfusions, grossesse) ;
- anémies hémolytiques auto-immunes.
Chez le nouveau-né atteint d’hémolyse par incompatibilité fœto- maternelle, la production de bilirubine déborde rapidement les possibilités d’épuration, faibles à cet âge. La bilirubine se répand dans les tissus riches en lipides et imprègne les noyaux gris centraux du cerveau. Cet ictère nucléaire peut être mortel ou laisser de graves séquelles neurologiques.
! Chez le nouveau-né suspect d’incompatibilité fœtomaternelle, le dosage de la bilirubine est une urgence : de son résultat découle l’indication d’une photothérapie.
Prévenir l’équipe soignante dès que la bilirubine totale est augmentée
Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application
- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com