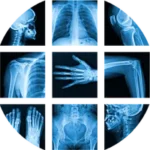Definition
L’epuration extra-renale est une methode d’elimination des secretions
(substances et liquides) en exces des reins afin de palier le deficit
de la fonction excretrice de ceux-ci.
Il existe
3 methodes d’epuration extra-renale :
- L’hemofiltration : mecanisme
d’ultrafiltration (convection). - L’hemodialyse : mecanisme de
diffusion (conduction). - L’hemodiafiltration : mecanismes
d’ultrafiltration
(convection) et de diffusion (conduction).
Mecanismes
de transfert des solutes
Il y a
deux mecanismes de transfert de solute pour la dialyse renale :
- La diffusion ou conduction.
- L’ultrafiltration ou convection.
La
diffusion
La diffusion ou conduction est le transfert passif de solute et de
molecules de
faibles poids moleculaire selon un gradient de concentration du milieu
le plus concentre vers le moins concentre.
Il n’y a
pas de passage de solvant (eau).
Lorsqu’on met en contact deux solutions (en l’occurrence, le sang et le
dialysat) contenant differentes concentrations de certaines substances, separees
par une membrane semi-permeable, les molecules qui les composent se repartissent
de l’une vers l’autre en se deplaeant du milieu le plus concentre vers le moins
concentre, jusqu’e l’obtention d’un equilibre. La membrane comporte une
multitude de trous de tailles differentes, de faeon a ce que les petites comme
les grosses molecules puissent la traverser, mais pas les cellules
sanguines.
Les mineraux en exces dans le sang vont passer dans le dialysat,
et reciproquement.
Elle est dependante de :
- La concentration de part et d’autre de
la membrane. - La surface d’echange : la membrane.

L’ultrafiltration
L’ultrafiltration ou convection est le transfert actif de
solute et de solvant (eau)
selon un gradient de pression hydrostatique de chaque cote de la
membrane, avec une pression positive dans le compartiment sanguin (chez
le patient) et une pression negative dans le compartiment du dialysat.
C’est ce phenomene qui va permettre de corriger l’exces de liquide dans le sang
du malade. On exerce une pression sur le compartiment sanguin, l’eau qu’elle
contient en exces traverse la membrane et rejoint le dialysat.
Elle est dependante du :
- Debit de filtration.
- La
taille des pores de la membrane : degre de porosite de la membrane (la
taille des pores de la membrane va limiter le transfert).
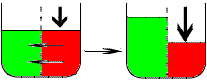
Indications
- Insuffisance renale aigue.
- Intoxications medicamenteuses.
- Retention hydrosodee severe d’origine
insuffisance cardiaque. - Troubles severes de la thermoregulation.
Materiel
- Un generateur :
- Le
generateur est alimente par de l’eau de qualite pour l’hemodialyse, il
prepare le dialysat et contrele son pH et sa temperature; il assure le
circulation du dialysat, l’ultrafiltration ainsi que la circulation
extra-corporelle. - Un dialyseur :
- Le
dialyseur ou hemofiltre ou rein artificiel est constitue d’une membrane
semi-permeable disposee de telle sorte qu’elle delimite un compartiment
interne dans lequel le sang circule, et un compartiment externe dans
lequel circule le dialysat en sens inverse. - Un abord vasculaire :
- L’hemodialyse necessite une voie d’abord
vasculaire capable de donner un debit de l’ordre de 300ml/ minute. - Catheter veineux de gros calibre e
double lumiere : femoral, sous-clavier, jugulaire interne. - Fistule arterio-veineuse :
- Quand
le vaisseau n’est plus de bonne qualite, le chirurgien cree un vaisseau
artificiel, la fistule : c’est l’anastomose de deux vaisseaux, une
artere et une veine. Le debit sanguin provenant de l’artere passera
ainsi en partie directement dans le reseau veineux peripherique, ce qui
provoquera un gonflement de la veine, sur plusieurs semaines,
permettant ainsi un acces privilegie pour les seances d’hemodialyse. - Un circuit extra-corporel :
- Ligne « arterielle » : allant du patient
vers le dialyseur. - Ligne « veineuse » : allant du dialyseur
vers le patient.
L’hemodialyse
L’hemodialyse fait appel au mecanisme de
diffusion
(conduction).
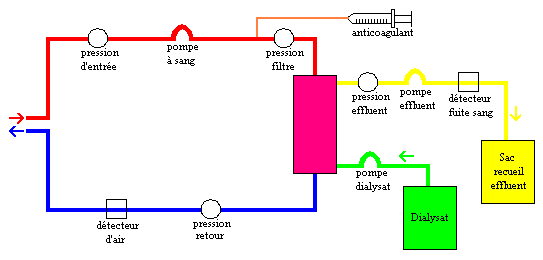
- Le sang est aspire par la ligne
« arterielle » (ligne rouge) par la pompe a sang. - Le
sang est melange a un anticoagulant qui permet d’eviter une coagulation
du sang dans le systeme d’epuration extracorporel par activation de la
coagulation au contact des materiaux exogenes. - Le sang passe a travers un dialyseur
permeable compose de fibres capillaires creuses. - Le
dialysat circule dans l’hemofiltre a contre-courant du flux
sanguin, la
membrane joue son rele de filtre, il n’y a pas de contact entre le
dialysat et le sang. - Le liquide effluent (filtrat) est
recueilli dans une poche suspendue a une balance qui calcule
le poids des sorties liquidiennes (filtrat). - La quantite de filtrat recueilli doit
correspondre a la perte de poids nette souhaitee. - Le
dialysat et le filtrat sont contreles par les pompes de dialysat et
d’effluent, qui calculent les entrees et les sorties liquidiennes. - Le sang hemodialyse est reinjecte au
patient par la ligne « veineuse » (ligne bleue).
L’hemofiltration
L’hemofiltration fait appel au mecanisme d’
ultrafiltration
(convection).
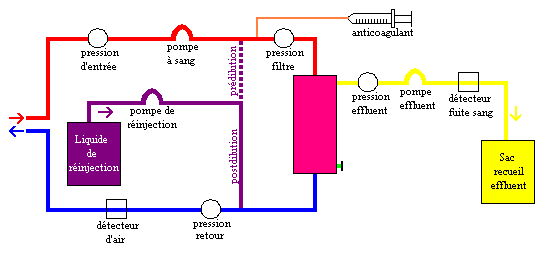
- Le sang est aspire par la ligne
« arterielle » (ligne rouge) par la pompe a sang. - Le
sang est melange a un anticoagulant qui permet d’eviter une coagulation
du sang dans le systeme d’epuration extracorporel par activation de la
coagulation au contact des materiaux exogenes. - Le sang passe a travers un dialyseur de
haute permeabilite compose de fibres capillaires creuses. - Une
solution sterile de substitution physiologique est injectee dans le
sang avant ou apres le dialyseur pour compenser la perte liquidienne.
Elle est suspendue a une balance qui permet de calculer les entrees
liquidiennes. - Predilution : injection sur la ligne
arterielle : avant le filtre. - Postdilution : injection sur la ligne
veineuse : apres le filtre. - Le liquide effluent (filtrat) est
recueilli dans une poche suspendue a une balance qui permet de calculer
les entrees liquidiennes. - Les balances et les pompes de
substitution et d’effluent, calculent les entrees et les sorties
liquidiennes et contrelent et compensent les
solutions de substitution et de filtrat. - Le sang hemofiltre est reinjecte au
patient par la ligne « veineuse ».
L’hemodiafiltration
L’hemofiltration
fait appel aux deux mecanismes de transfert de solute,
l’
ultrafiltration
(convection) et la
diffusion
(conduction).
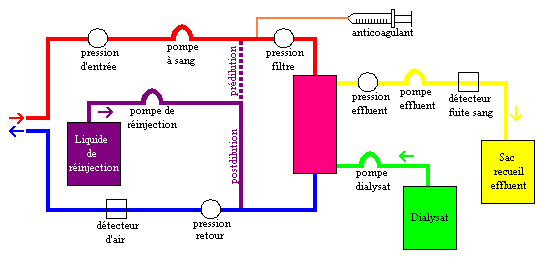
- Le sang est aspire par la ligne
« arterielle » (ligne rouge) par la pompe a sang. - Le
sang est melange a un anticoagulant qui permet d’eviter une coagulation
du sang dans le systeme d’epuration extracorporel par activation de la
coagulation au contact des materiaux exogenes. - Le sang passe a travers un dialyseur de
haute permeabilite compose de fibres capillaires creuses. - Le
dialysat circule dans l’hemofiltre a contre-courant du flux sanguin, la
membrane joue son rele de filtre, il n’y a pas de contact entre le
dialysat et le sang. - Une
solution sterile de substitution physiologique est injectee dans le
sang avant ou apres le dialyseur pour compenser la perte liquidienne.
Elle est suspendue a une balance qui permet de calculer les entrees
liquidiennes. - Predilution : injection sur la ligne
arterielle : avant le filtre. - Postdilution : injection sur la ligne
veineuse : apres le filtre. - Le liquide effluent (filtrat) est
recueilli dans une poche suspendue a une balance. - La
solution de substitution, le filtrat et le dyalisat sont contreles et
compenses par les balances et par les pompes de substitution, de
dialysat et d’effluent, qui calculent les entrees et les sorties
liquidiennes. - Le sang hemodiafiltre est reinjecte au
patient par la ligne « veineuse ».
Risques
et complications
Cliniques
- Embolie gazeuse : toux, dyspnee,
cyanose, agitation, vomissement. - Mettre le patient en position declive,
arreter la dialyse, prevenir le medecin, surveiller les signes. - Pression arterielle :
- Hypertension arterielle.
- Hypotension
arterielle (beillement, nausees, sueurs, gaz voire diarrhee) : liee e
un debit trop rapide ou a une perte de poids elevee. - Rythme cardiaque :
- Troubles du rythme : lies a une
hypovolemie ou une hypokaliemie. - Etat general :
- Hypothermie : defaut de chauffage du
dialysat. - Crampes : debit d’ultrafiltration trop
eleve. - Cephalees : hypertension arterielle ou
diminution du taux d’uree.
Techniques
- Entree d’air dans le circuit.
- Coagulation du circuit sanguin.
- Pression transmembranaire elevee,
superieure a celle du sang : obstruction. - Deconnexion.
Surveillances
et evaluations
Avant la dialyse et entre les seances
- Etat
de la fistule : aspect de la veine, qualite du souffle et du thrill (la
fistule doit fremir a la palpation et etre audible a l’auscultation). - Pression arterielle : avant et apres.
- Poids : avant et apres.
Pendant la dialyse
- Etat general du patient : nausees,
vomissements, crampes, beillement. - Pression arterielle.
- Contrele
des debits: - Debit sang (ml/min) : est
determine par le debit
cardiaque du patient, le resistance interne du circuit a l’ecoulement
du sang et le difference de pression entre l’artere et la
veine. - Debit liquide effluent (ml/min).
- Debit restitution (ml/min).
- Debit dialysat (ml/min).
- Contrele
des pressions: - Pression
entree (mmHg) : - limites usuelles : – 50 / +150 mmHg :
- doit etre negative (aspiration).
- max – 250 mmHg.
- proche de 0 si debit faible.
- Si de plus en plus negative : debut de
coagulation du catheter : rincer avec Nacl 0,9% ou heparine de rineage. - Pression
trans-membranaire (PTM) : filtre (mmHg) : represente la
difference de
pression entre le compartiment sanguin (pression arterielle, pression
veineuse) et le compartiment ultrafiltrat. - limites usuelles : +100 / +250 mmHg.
- si de plus en plus positive : debut de
coagulation du filtre : verifier et remettre a zero le niveau de la
chambre de degazage. - Pression
effluent (mmHg) : - limites usuelles : -150 / +50 mmHg.
- Si de plus en plus positive : debut de
coagulation du filtre : verifier et remettre a zero le niveau de la
chambre de degazage. - Pression
retour (mmHg) : limites usuelles : +50 / +150 mmHg : - doit etre positive (restitution).
- max +350 mmHg.
- si de plus en plus positive : debut de
coagulation du catheter : rincer avec Nacl 0,9% ou heparine de rineage. - Contrele de la seringue d’anticoagulant.
- Contrele des lignes : absence de pliure,
de fuite, de bulle d’air.
Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application
- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com