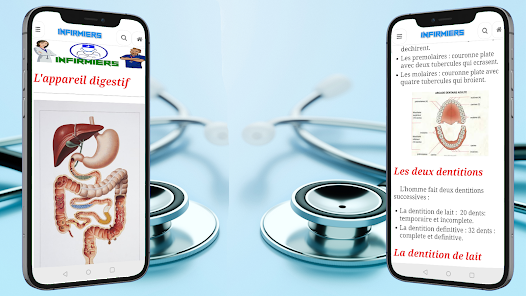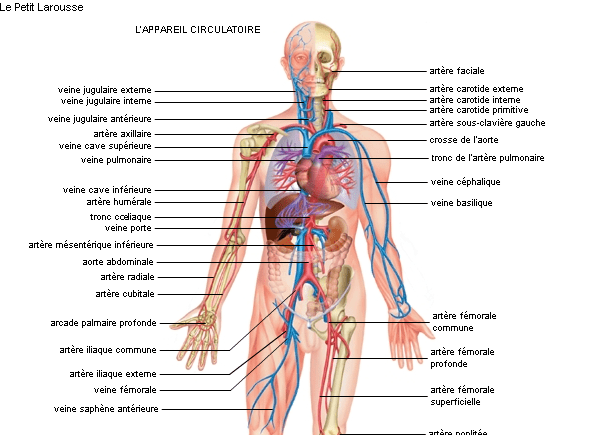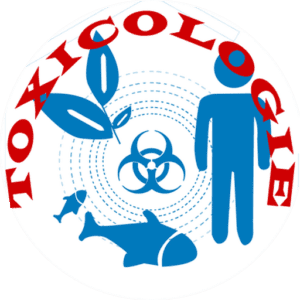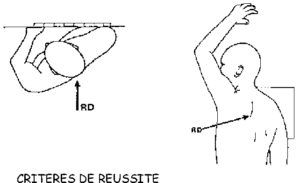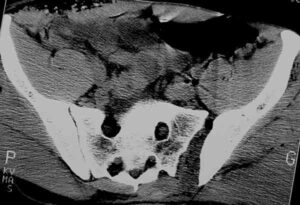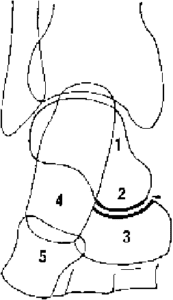Definition
La salle
de surveillance post-interventionnelle (SSPI) accueille durant une plus
ou moins longue duree, l’ensemble des patients relevant d’une
surveillance post-anesthesique et ayant subi une intervention
chirurgicale.
Objectifs
- Accueil et installation du patient, en
securite, confortablement et selon les prescriptions medicales et
anesthesiques. - Surveillance et maintien des grandes
fonctions vitales. - Prevenir et traiter toutes complications.
- Evaluation et prise en charge de la
douleur.
Organisation
de la salle
de surveillance post-interventionnelle
Selon le
decret 94-1050 du 5 decembre 1994 :
- La SSPI doit se situer a proximite des
sites operatoire et permettre l’admission de tous les patients des la
fin de l’intervention hormis les patients dont l’etat de sante
necessite une admission directe en reanimation - La SSPI doit comporter au moins 4 postes.
- Un infirmier dipleme d’etat, si possible
infirmier anesthesiste doit etre present en permanence et place sous la
responsabilite d’un medecin anesthesiste-reanimateur qui doit pouvoir
intervenir sans delai. - Chaque poste doit etre equipe d’une
arrivee de fluides medicaux, d’une prise de vide, d’un cardioscope,
d’un saturometre, d’un appareil de mesure de la pression arterielle et
d’un moyen de rechauffement du patient. - La SSPI doit etre pourvue d’un
dispositif d’assistance ventilatoire muni d’alarmes, d’un
defibrillateur et d’un curarometre. - L’integralite des informations
recueillies lors de la surveillance continue postinterventionnelle est
transcrite dans un document classe dans le dossier medical du patient.
Surveillances
en SSPI
En SSPI le
patient beneficie d’une surveillance clinique et instrumentale
constante et adaptee a son etat.
- Surveillance
respiratoire: - Sevrage ventilatoire.
- Extubation.
- frequence respiratoire.
- Amplitude et symetrie des mouvements
thoraciques. - Oxymetrie de pouls.
- Surveillance du ventilateur.
- Etat cutane.
- Risque de
depression respiratoire morphinique.
- Surveillance
cardio-circulatoire : - Frequence cardiaque.
- Pression arterielle.
- Moniteur ECG.
- Surveillance
neurologique : - Etat de conscience.
- Recuperation
des reflexes. - Tonus musculaire.
- Motricite spontanee.
- Disparition des
effets des produits anesthesiques.
- Surveillance
digestive : - Sondage gastrique.
- Existence de nausees et vomissements :
risque du syndrome
de Mendelson.
- Surveillance
renale : - Sondage vesicale.
- Globe vesical.
- Diurese spontanee.
- Surveillance
des acces vasculaires: - Debit.
- Nature du produit.
- Point de ponction, verifier l’absence de
signe d’inflammation : douleur, rougeur, chaleur, œdeme. - Permeabilite et integrite de l’acces
vasculaire. - Absence de coudure de la ligne de
perfusion
- Surveillance
de la zone operatoire : - Pansements.
- Drains.
- Pertes sanguines.
- Surveillance
de la temperature: - Temperature : hypothermie due e
la basse temperature
du bloc operatoire et a l’anesthesie generale. - Couverture chauffante.
- Risques de l’hypothermie et des frissons
au reveil post-anesthesique : - L’hypothermie retarde le reveil en
abaissant la MAC (Monitored Anesthesia Care : suivi de soins
d’anesthesie) des halogenes et fait apparaetre une curarisation
residuelle au reveil. - La depense energetique necessaire au
retablissement de la normothermie majore la consommation en
oxygene. - Le frisson s’accompagne d’une
hypercatecholaminemie et d’une vasoconstriction entraenant
une augmentation de la pression arterielle et du debit
cardiaque. Le frisson repond bien aux morphiniques et aux
alpha-2 agonistes.
- Surveillance
de la douleur: - Intensite de la douleur : la douleur
en post-operatoire est aigue pendant les 24 premieres heures
apres une intervention et decroet en general en 3 a 4 jours. - Echelle visuelle analogique : EVA.
- Echelle verbale simple : EVS.
- Evaluation de la douleur chez un patient
inconscient : - Sueurs.
- Peleur.
- Tachycardie.
- Hypertension arterielle.
Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application
- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com