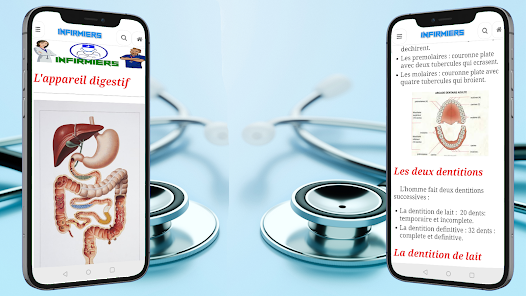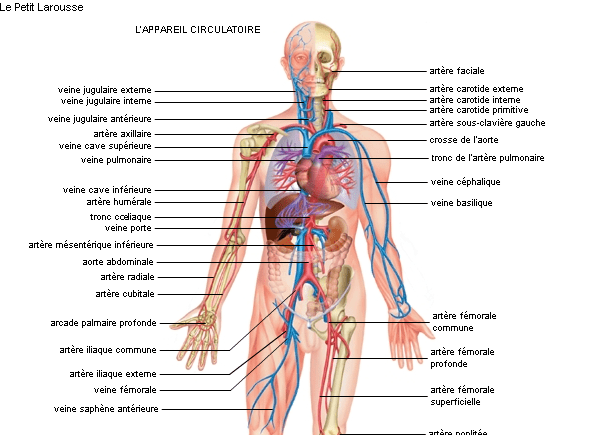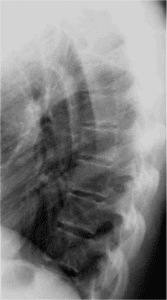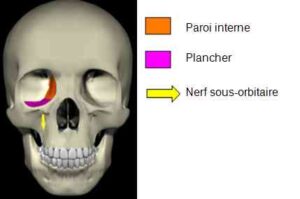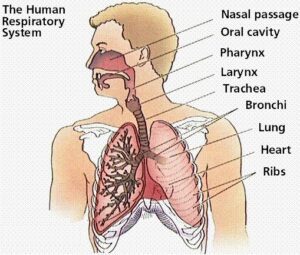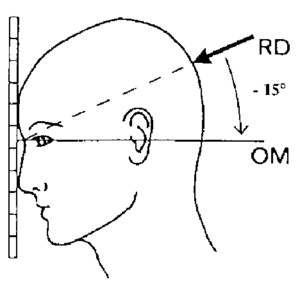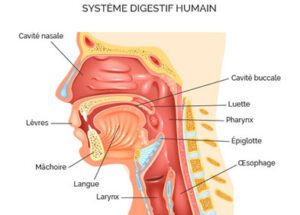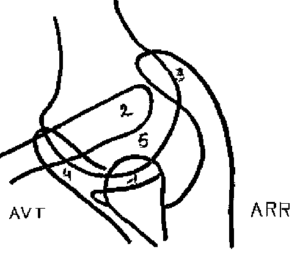Spécialité : metabolisme / pédiatrie / traumatologie /
Points importants
- Fréquente : traumatologie, immobilisations prolongées, intoxications
- A rechercher (CPK, BU)
- Traitement rapide car pronostic vital (hyperkaliémie, CIVD) et fonctionnel (IRA, gangrène, amputation)
- Traitement = hydratation +++
- Entraîne une insuffisance rénale aiguë dans 8-15% des cas
- 5% de mortalité
Présentation clinique / CIMU
SIGNES FONCTIONNELS
Variables +++ et non spécifiques, les signes de la cause étant au premier plan
Généraux
- Asthénie voire coma
- Ou agitation
- Nausées / vomissements
Spécifiques
- Myalgies
- Urines rouges ou brunes : classique mais inconstant, de rosées à noirâtres
CONTEXTE
Circonstances de survenue
- Traumatologie : ischémie musculaire et lyse par compression directe ou écrasement (crush syndrome) ou brûlure
- Comas, overdoses, immobilisations prolongées : par compression directe ou par ischémie en aval d’un axe vasculaire comprimé
- Utilisation excessive de l’énergie :
- sepsis sévère, infections virales et bactériennes
- toute contraction musculaire répétée : effort musculaire intense, états d’agitation (delirium, bouffées délirantes, intoxication à la cocaïne…), crises convulsives, tétanos, électrisation
- coup de chaleur, syndrome malin des neuroleptiques et hyperthermie maligne
- plus rarement : orages catécholaminergiques : phéochromocytome, crise aiguë thyrotoxique…
- Poisons métaboliques : CO, cyanure, certains métaux (mercure, fer, cuivre)
- Déplétion potassique : abus de laxatifs et diurétiques, minéralocorticoïdes
- Toxicité musculaire directe :
- myosites virales ou auto-immunes
- statines +++ et clofibrate, mais aussi corticoïdes, antipaludéens, intoxication alcoolique chronique et aiguë
- certaines associations : statines + jus de grenade ou jus de pamplemousse (inhibition du cytochrome P450)
EXAMEN CLINIQUE
- Pas de signes cliniques si forme non grave
- Rash cutané
- Possibilité d’HoTA (hypovolémie)
- Possibilité de syndrome de loge secondaire, tension musculaire avec oedème des masses musculaires, possibilité d’atteinte sensitive et motrice d’une ou plusieurs masses musculaires, voire tableau d’atteinte spinale
- Nécrose musculaire +/- étendue, ischémie locale ou d’aval, infection voire gangrène, amputation (cas graves)
EXAMENS PARACLINIQUES SIMPLES
- BU : recherche d’hémoglobinurie, pH urinaire (acide si < 6)
- ECG : signes liés à l’hyperkaliémie
- SpO2 : contexte d’état de choc
CIMU
- Tri 1 ou 2
Signes paracliniques
BIOLOGIQUE
- CPK : diagnostic et évolution. Cinétique : pic au 3° jour :
- rhabdomyolyse si > 1000 UI/L
- grave si > 7000
- sévère si > 16000
- Myoglobine : moins sensible
- ASAT et LDH : peuvent augmenter mais non spécifiques
- Gazométrie artérielle et bicarbonates sanguins : recherche d’acidose métabolique
- Ionogramme sanguin :
- dyskaliémie : hyperkaliémie avec insuffisance rénale aiguë, hypokaliémie voire kaliémie normale si la déplétion potassique est la cause
- insuffisance rénale aiguë : nécrose tubulaire aiguë ou précipitation tubulaire de la myoglobine, hypovolémie
- réserve alcaline basse
- Recherche d’hypocalcémie et d’hyperphosphorémie (relargage cellulaire)
- Acide urique : recherche d’hyperuricémie
- Coagulation intraveineuse disséminée (CIVD) : D-dimères augmentés, thrombopénie < 100 000 (grave si < 50 000), TP < 65% (grave si < 50%), fibrinogène < 1g/L
- Ionogramme urinaire : quantifier et guider le traitement de l’insuffisance rénale
IMAGERIE
- Body-scan et recherche de fractures si patient traumatisé
- Tous examens liés à la pathologie causale
- Pression des loges musculaires : ischémie si Pression > 40 mmHg pendant plus de 8h
Diagnostic étiologique
Traumatologie
- Traumatisme fermé sévère
- Lésion électrique de haut voltage
- Brûlures extensives
- Immobilisations prolongées
Activité musculaire excessive
- Exercice inhabituel éprouvant (marathon)
- Crise convulsive
- Asthme aigu grave
- Dystonie sévère
- Psychose aiguë
Toxique
- Ethanol, méthanol, éthylène glycol
- Héroïne
- Méthadone
- Barbituriques
- Cocaïne
- Amphétamine
- LSD (lysergic acid diethylamide)
- Monoxyde de carbone
- Toluène
- Envenimations par serpent, araignées
Causes environnementales
- Hyperthermie
- Hypothermie
Causes métaboliques
- Hyponatrémie, hypernatrémie
- Hypokaliémie
- Hypophosphatémie
- Hypo ou hyperthyroïdie
- Acidocétose diabétique
- Coma diabétique hyperosmolaire
Infections virales
- Influenza de type A et B
- VIH
- Virus Coxsackie
- Le virus Epstein-Barr
- Echovirus
- Cytomégalovirus
- Adénovirus
- Herpes simplex
- Virus parainfluenzae
- Varicelles – zona
Infections bactériennes
- Streptococcus pneumoniae
- Streptocoques du groupe bêta
- Streptococcus pyogènes
- Staphylocoque epidermidis
- Escherichia coli
- Clostridium perfringens
- Clostridium tetani
- Plasmodium
- Rickettsia
- Salmonelles
- Listeria
- Legionella
- Mycoplasmes
- Brucella
- Leptospira
Infections fongiques
- Candida
- Aspergillus
Polymyosite, dermatomyosite, myopathie
Médicaments
- Anti-histaminiques
- Salicylates
- Caféine
- Neuroleptiques/antipsychotiques
- Anesthésiques, curares (hyperthermie maligne)
- Amphotéricine B
- Quinine
- Corticoïdes
- Statines
- Théophylline
- Anti-dépresseurs tricycliques
- Inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine
- Acide aminocaproïque
Diagnostic différentiel
- Elévation des CPK liée à un syndrome coronarien
- Hémoglobinurie
Traitement
TRAITEMENT PREHOSPITALIER / INTRAHOSPITALIER
Lutte contre l’hypovolémie +++
Stabilisation initiale
- Patient incarcéré :
- scope ECG dès que possible, pose de voie veineuse périphérique
- remplissage vasculaire avant la levée de la compression (NaCl 0,9% ou macromolécules, pas de solutés contenant du potassium)
- si incarcération prolongée : risque d’hyperkaliémie brutale et sévère à la levée de compression : liée à la lyse musculaire, majorée si utilisation de célocurine pour l’intubation trachéale : alcalinisation et injection de chlorure de calcium
- Aux urgences / au déchocage :
- remplissage, au mieux guidé par l’échographie cardiaque. NaCl 0,9% 500 mL/h pour avoir une diurèse horaire de 200 – 300 mL
- évaluation et suivi de la diurèse (SAD « facile »)
- correction des troubles ioniques
- contrôle de la température :
- lutte contre l’hypothermie : couvertures chauffantes, réchauffement des perfusions et transfusions…si patient intubé/ventilé et sédaté : curarisation pour éviter les frissons liés au réchauffement
- ou à l’inverse, lutte contre l’hyperthermie si coup de chaleur/ hyperthermie maligne…
- si délabrement cutané : parage/ lavage, antibioprophylaxie à visée anti-anaérobies (max 48 heures), vérification de la vaccination antitétanique
Suivi du traitement
- En service de post-urgences ou en réanimation selon la pathologie causale
- Traitement et prévention des complications générales (surtout rénales) :
- hydratation : apports de base 30 à 35 mL/kg/j + apport complémentaire de NaCl 0,9% afin d’obtenir une diurèse de 1 mL/kg/h, voire 2 à 3 mL/kg/h si rhabdomyolyse sévère. Limites : attention si oedème pulmonaire lié à des contusions par exemple. Guidage par l’échographie cardiaque au moindre doute
- correction des troubles ioniques :
- K+ : cf. chapitre
<a « pathologies_34″= » »>hyperkaliémie - compensation en calcium et phosphore
- K+ : cf. chapitre
- épuration extra-rénale (EER) en réanimation en cas d’insuffisance rénale aiguë ne répondant pas au remplissage. L’EER préventive en cas de rhabdomyolyse sévère mais avant l’installation d’IRA oligo-anurique n’a pas montré de bénéfice
- alcalinisation : classique mais non pratiqué de façon universelle et bénéfice non prouvé. Néanmoins recommandé si CPK > 6000 UI/L, acidose, insuffisance rénale préexistante, déshydratation :
- bicarbonates à 1,4%, 100mL/h pour obtenir un pH urinaire > 7
- mannitol : classique mais bénéfice non prouvé et risques d’effets secondaires, quasiment abandonné
- diurétiques : « diurèse forcée » classique mais à abandonner : l’IRA est certes liée à la précipitation de la myoglobine dans les tubules, mais seulement en cas d’association hypovolémie + urines acides : la diurèse forcée aggrave l’hypovolémie, masque l’oligurie et acidifie les urines
- CIVD : transfusion de PGR, PFC, fibrinogène et plaquettes en fonction du contexte et des bilans biologiques
- prévention des thromboses veineuses chez les patients alités, après stabilisation initiale et en l’absence de lésion à risque hémorragique associée
- certains auteurs proposent des traitements anti-oxydants (lutte contre les radicaux libres) : vitamines E et C, zinc, sélénium et manganèse, mais bénéfice non prouvé
- l’administration de calcium n’est pas recommandée
- Complications locales ou locorégionales :
- surveillance des loges musculaires, recherche d’ischémie d’aval (clinique, doppler)
- certaines équipes proposent la surveillance de la pression musculaire : ischémie si pression > 40 mmHg ou PAD – 30 mmHg pendant 6 à 8h
- aponévrotomie de décharge si syndrome des loges lié à l’augmentation de pression dans les loges musculaires. Risque infectieux+++
- Excision des muscles nécrosés (sans urgence)
Surveillance
CLINIQUE
- Diurèse +++/h
- Etat général : asthénie, hyperventilation
- Œdème musculaire, pouls et coloration des membres, état cutané
- ECG voire scope si hyperkaliémie
- pH urinaire (BU)
PARACLINIQUE
- CPK/6-12 h
- Ionogramme sanguin : kaliémie, urée/ créat, calcium, phosphore
- Ionogramme urinaire : calcul de la clairance de la créatinine
- Cas particulier de l’enfant : causes et pronostic différents de l’adulte :
- myopathies et myosites +++
- moins de risque d’IRA
- pas d’intérêt au traitement par bicarbonate
Devenir / orientation
CRITERES D’ADMISSION
- Service d’hospitalisation si CPK < 10 000, troubles ioniques non menaçants, pas de nécessité de scope
- Réanimation si nécessité de scope ou IRA, CIVD voire défaillance multiviscérale
CRITERES DE SORTIE
- Liés à la pathologie causale
- Normalisation des troubles ioniques et de la fonction rénale
- Etat cutané satisfaisant
Mécanisme / description
- Rhabdomyolyse :
- liée à la lyse des fibres musculaires striées dont le contenu est libéré dans la circulation générale
- causes (cf. étiologies) : toute situation entraînant un déséquilibre entre apports et besoins métaboliques :
- apport insuffisant en oxygène par compression vasculaire d’amont ou compression musculaire directe
- utilisation excessive d’énergie : toute contraction musculaire intense et répétée
- poisons métaboliques : toute interaction avec les systèmes de production d’ATP
- déplétion potassique : par gêne à la regénération de phosphocréatine et à la glycogénolyse
- toxicité musculaire directe par de nombreux toxiques et médicaments
- Insuffisance rénale aigue (30 – 40 % des cas) : nécrose tubulaire aigue :
- par précipitation de la myoglobine et de cristaux d’acide urique dans les tubules
- aggravée par le pH acide des urines (< 6)
- étroitement liée à la perfusion rénale : pas d’IRA malgré des taux élevés de CPK et myoglobine si pas d’hypovolémie
- hypovolémie (séquestration d’eau plasmatique dans les myocytes lésés)
- Défaillance multiviscérale : liée à l’association hypovolémie, acidose métabolique, troubles ioniques, et au syndrome d’ischémie/ reperfusion, en plus de la pathologie causale
Bibliographie
- B. Vigué in « Anesthésie-réanimation chirurgicale », K.Samii et al, chapitre 57, p 847- 854
- A. Ellrodt in « Urgences médicales », édition 2002, p 180-181
- Brown et al. Preventing renal failure in patients with rhabdomyolysis : do bicarbonate and mannitol make a difference? J Trauma 2004; 56: 1191-96
- Mannix et al. Acute pediatric rhabdomyolysis : causes and rates of renal failure. Pediatrics 2006; 118: 2119-2125
- Fernandez et al. Factors predictive of acute renal failure and need for hemodialysis among patients with rhabdomyolysis. Am J Emergency Med 2005; 23: 1-7
- Alardin et al. Bench to bedside review : rhabdomyolysis- an overview for clinicians. Critical Care 2005; 9:158-169
Auteur(s) : Oriane FONTAINE- KESTELOOT
Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application
- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com